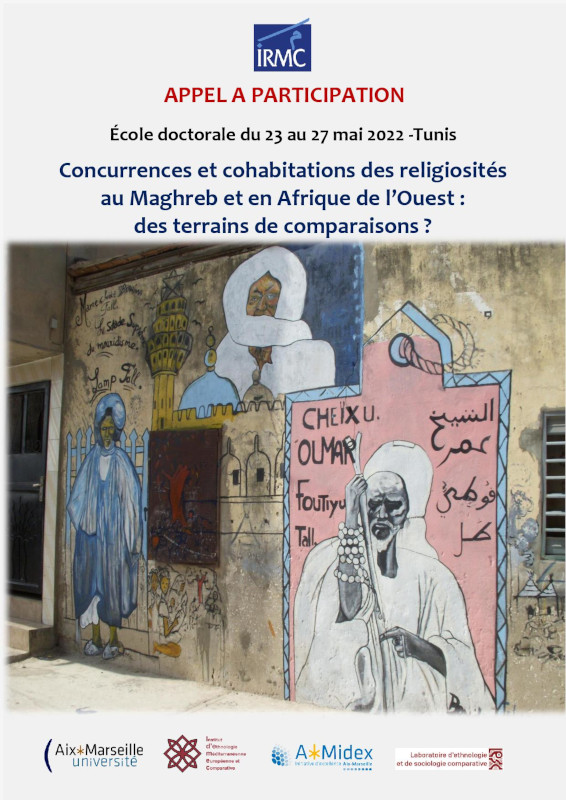L’IRMC organise l’école doctorale thématique : « Concurrences et cohabitations des religiosités au Maghreb et en Afrique de l’Ouest : des terrains de comparaisons ? », organisée dans le cadre du projet A*Midex.
Détails
Coordination : Katia Boissevain, directrice de l’IRMC et Anouk Cohen, LESC.
Quand et où ?
Du 23 au 27 mai 2022
Tunis
Argumentaire
Les faits religieux occupent une centralité indéniable dans les sociétés maghrébines et africaines depuis les années 1980, tant au niveau politique que social. Qu’il s’agisse du point de vue politique avec les reconfigurations partisanes, de celui des normes et des valeurs en perpétuelle redéfinition (rapport au corps, notion de mixité, codes et modes vestimentaires), ou des enjeux économiques liés à la « chose religieuse » (produits halal, tourisme religieux, politiques patrimoniales, finance islamique, marketing « islamique »), les références religieuses foisonnent, s’inventent, mutent et semblent parfois surdéterminantes dans le champ des offres et des consommations. Cette référence religieuse, musulmane et chrétienne (catholique comme protestante), se construit en tension entre un discours d’apaisement, de cohabitation et un discours de combat et de prééminence. Des divergences peuvent se manifester entre leaders des deux religions majoritaires aussi bien qu’au sein de chacune d’entre elles. Les raisons des différentes acceptions des normes religieuses sont nombreuses et peuvent être liées à des interprétations endogènes du référentiel canonique, à des hiérarchies historiques, à des transformations internes, voire à des phénomènes de migration à l’origine de formes de « déplacements » et des reconfigurations religieuses.
Face à la complexification du paysage religieux contemporain, et face à la diversité dans ses conséquences symboliques et pratiques, quels enjeux réflexifs se posent pour les sciences humaines et sociales ?
Présentation de la proposition
Cette école doctorale a été conçue dans l’optique de fédérer les recherches portant sur les faits religieux au Maghreb et en Afrique de l’Ouest afin de comparer les dynamiques à l’œuvre, qu’il s’agisse des effets des migrations, des concurrences des églises et des confréries soufies, des enjeux territoriaux, ou des questions de conversion.
Sur les terrains religieux explorés, nous assistons à une surenchère dans le repositionnement entre diverses religions, et en leur sein même ; religions qui sont de plus en plus nombreuses à se partager les mêmes territoires. La réflexion sera ici une manière de penser des modes de cohabitations entres des pratiques et des expériences religieuses diverses. Comment opèrent les relations, sur un territoire particulier, soit-il géographique, pluri-localisé ou virtuel ?
Notre ambition est de proposer une analyse des sociétés maghrébines et africaines et des changements religieux qui les traversent en se fondant sur les savoirs faires des diverses disciplines et sur les comparaisons qu’elles permettent. En effet, la gestion de la diversité religieuse et l’émergence de revendications de la part de fidèles d’obédiences différentes apparaissent comme une problématique partagée au Maghreb et en Afrique de l’Ouest et les historiens, anthropologues et politistes se saisissent de ces questions avec les outils et les méthodes qui leur sont propres.
Nous nous intéresserons également à la dimension de recherche appliquée que revêtent parfois les SHS. Quels usages en font divers acteurs publiques ou privés (ONG, think-tanks) ?
Concrètement, nous proposons d’observer les méthodes employées par les acteurs pour diffuser et consolider les messages religieux –quels qu’ils soient- en nous attachant aux différents niveaux, institutionnels, domestiques, économiques. Nous souhaitons éviter la particularisation de l’étude des groupes religieux au profit d’une analyse croisée, embrassant les divers acteurs qui occupent – et composent – les champs religieux des terrains d’observation.
A l’occasion de cet atelier doctoral, nous proposons à des doctorant.e.s travaillant sur des questions religieuses en Afrique de l’Ouest et au Maghreb, de présenter leurs recherches en mettant en lumière, de manière comparative, les dynamiques de coprésence intra et inter confessionnelles.
À partir d’une analyse de l’usage des matérialités, des discours et des écrits religieux, les doctorant.e.s s’efforceront d’appréhender les manières dont les acteurs de divers courants (militants, cadres, croyants, missionnaires, convertis, etc…) travaillent les mêmes territoires qu’ils s’efforcent de gagner à leur cause.
Le but sera de mettre en commun des compétences et des connaissances afin de favoriser des synergies et de familiariser les doctorant.e.s à des outils théoriques et méthodologiques forgés dans des disciplines SHS.
Nous privilégierons quatre axes de réflexion :
1. Une approche critique des notions de la cohabitation et/ou concurrence religieuse
-Rompre avec les classifications et penser les pluralités inhérentes aux religions.
-Explorer les logiques des (re)compositions religieuses. Réflexions autour des notions de rivalité, syncrétisme, hybridation, métissage, branchements, bricolage, butinage et cumul.
2. Pratiques linguistiques : une reconfiguration des enjeux ?
-Langues parlées, langues écrites (sacralisée ou non) : enjeux, accommodements et inventions
-Traduction et transcription : langues, alphabets et déviations
3. Supports et pratiques de transmission du savoir religieux
-Corps, habillement, talismans, prière, livres et supports matériels
-Les nouvelles technologies comme voie de prosélytisme ou de réaffirmation religieuse
-Rituels, convergences et divergences
4. Méthodologie : Enquêter sur un terrain caractérisé par des concurrences et/ou cohabitations religieuses
-Pour ne pas essentialiser les groupes étudiés ni reproduire des idéologies religieuses, les propositions porteront plus sur « la confrontation des catégories structurantes » (Mary, 2001 : 30) et moins sur l’analyse du contenu des croyances. A cette fin, une réflexion méthodologique s’impose.
-La négociation de l’accès au terrain et ses difficultés : la question de la mise en scène et de la position éthique du chercheur
-L’approche par les matérialités religieuses et le « portrait anthropographique » pour mieux aborder la façon dont les individus construisent leur rapport personnel au religieux et comment ils le mettent en scène dans leur quotidien
-Nous favoriserons les recherches (de terrain ou d’archives) originales qui portent sur la pratique religieuse.